En 2007, au moment du 34eme congrès du PCF, j’ai publié dans la tribune de discussion préparatoire une contribution dans laquelle j’estimais que « la seule démarche qui, selon moi, soit porteuse d’espoir, serait de construire une nouvelle cohérence autour de deux principes fondateurs : le dépassement du capitalisme (abolition/remplacement) et l’articulation du combat anticapitaliste aux luttes contre toutes les formes d’exploitation, d’oppression, de domination et d’aliénation ». A ce stade de ma réflexion, j’avais précisé que « c’est délibérément que je ne retiens pas le vocable communiste ». J’étais alors convaincu que nous, les membres du PCF, devions créer un nouveau parti qui remplacerait le parti communiste et se donnerait un nom dans lequel ne figurerait pas le mot, communiste. J’en étais resté là, et en rejetant ce mot pour désigner une société non-capitaliste, je pensais en être quitte.
1- 2018-2022, NOUVELLES RÉFLEXIONS SUR « LE COMMUNISME »
Bien des années plus tard, le vocable communiste m’est revenu comme un boomerang avec la publication d’une interview de Lucien Sève dans l’Humanité du 9 novembre 2018. Il y était question de la publication du tome IV de sa tétralogie : Penser Marx aujourd’hui, sous le titre : Le communisme , 2019 (1). Ce qu’il expliquait m’avait stupéfié. Il disait avoir démontré dans son livre qu’il n’y avait rien eu de communiste dans l’histoire du siècle dernier. C’était prendre à contre pied l’idée, donnée comme une évidence, que le communisme d’hier ayant échoué, il avait entraîné dans sa chute la visée communiste, elle même. A partir de ce moment, j’ai été de nouveau happé par la thématique du communisme. Ma première source de réflexion, d’une importance considérable pour moi, a donc été le livre de Sève. A la suite de quoi, j’ai découvert des textes du philosophe -économiste, Frédéric Lordon. Il y faisait connaître l’importance qu’il accordait aux travaux de Bernard Friot sue « le salaire à vie ». Ce qui m’a amené à relire avec un regard nouveau trois des livres de ce dernier : Émanciper le travail, 2014 (2), Vaincre Macron, 2017 (3), Réussir le communisme, 2018 (4). En 2021, paraissait le livre de Frédéric Lordon : Figures du communisme (5) dans lequel il affirme que « sortir du capitalisme a un nom : communisme ». Et, sans pour autant faire référence à Sève, il ajoute que « la fatalité du communisme est de n’avoir jamais eu lieu et pourtant d’avoir été grévé d’images désastreuses ». La même année était publié un livre d’entretiens entre Bernard Friot et Frédéric Lordon : En travail, conversation sur le communisme, 2021 (6), dans lequel est évoquée à plusieurs reprises la question du « déjà-là communiste ». Enfin, à la fin de l’année 2021 paraissait, après la mort de Lucien Sève, son livre inachevé : Quel communisme pour le XXIe siècle ? (7), qui était la deuxième partie du tome IV sur « le communisme ». L’intérêt majeur de ce livre est qu’y sont discutées des réflexions les plus marquantes sur la visée communiste produites par, entre autres, Pierre Bardot et Christian Laval, Alain Badiou, Etienne Balibar et Bernard Friot.
Il m’aura donc fallu plus de dix ans avant de reprendre, à nouveaux frais, ma réflexion sur la visée communisme, instruit par la lecture des ouvrages référencés ci-dessus. Plus récemment, j’ai lu Abolir l’exploitation 2023 (8) de Emmanuel Renault. Puis, sur une question plus difficile pour moi portant sur les utopies et les possibles, le livre : La perspective du possible, 2022 (9) de Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre, puis Utopies réelles du sociologue américain Erik Olin Wright, 2020 (10) (publié en 2017 en langue anglaise). Je précise mes références afin que soient justement évaluées les limites de ma réflexion théorique sur la visée communiste. Je fais remarquer que ces travaux n’émanent pas d’intellectuels membres du PCF, hormis ceux de Bernard Friot, par ailleurs contesté sans ménagement au sein du PCF, (Lucien Sève avait quitté le parti en 2010).
Enfin, pour penser la visée communiste, je tiens à préciser que je n’ai pas éprouvé le besoin de lire (ou relire) quoi que ce soit de Marx, Lénine et Gramsci.
2- LE COMMUNISME N’A JAMAIS EU D’EXISTENCE
La visée communiste implique le dépassement du capitaliste, dépassement au sens marxien du terme, soit le processus couplant abolition et remplacement. De ce processus, on sait précisément ce dont on part : le capitalisme, mais on ne sait que très vaguement où l’on va : le communisme.
Ce dont on est sûr, c’est que le capitalisme est fondé sur le triptyque : exploitation, aliénation, domination (EAD) qui se décline concrètement, sous des formes spécifiques et imbriquées, à tous les niveaux de la société : pouvoir politique, pouvoir économique, sphère professionnelle, sphère domestique (patriarcat), systèmes : éducatif, sportif, santé, culture. Recherche…
Ce que l’on ne connaît pas, c’est le communisme. Je pose d’emblée qu’aucune expérience historique n’a relevé d’une visée communiste. Je fais mienne la thèse de Lucien Sève et d’autres chercheurs, selon laquelle il n’y a jamais rien eu qui puisse être qualifié de communiste dans l’expérience soviétique et celles de ses satellites. Ces expériences ont été à rebours d’une visée communiste, en ce qu’elles ont été conduites, jusqu’à leur disparition, par des partis-États, les partis communistes de ces pays, pour avoir privilégié une économie productiviste et étatiste et soumis leurs sociétés à un contrôle despotique : autoritarisme, bureaucratie et répression (politique, judiciaire et policière), autant de caractéristiques répondant à la définition d’un système totalitaire. L’expérience chinoise ne peut pas plus nous inspirer, en ce qu’elle est contrôlée par un parti-État, et qu’elle est caractéristique d’un capitalisme d’État imposé par des méthodes autoritaires et répressives. Le cas de Cuba est plus problématique du fait de l’embargo américain. Reste que la conduite de l’expérience cubaine sous la férule d’un parti unique n’incite pas à qualifier cette expérience comme relevant d’une visée communiste.
3- LOCAL/ GLOBAL, VERTICALITÉ/HORIZONTALITÉ
Si le communisme n’a jamais eu d’existence, pour penser la visée communiste, il faut « inventer », ex nihilo, en tout domaine. La norme serait que toute invention ne puisse être génératrice, d’aucune des tares ontologiques qui définissent les EAD : dépendance, injustice, oppression, subordination, infériorisation, servitude, obéissance, soumission, Dans le système capitaliste, ces tares sévissent massivement dans le secteur privé soumis, sans exception, aux diktats patronaux et actionnariaux. Pour autant, les entreprises publiques ne sont pas épargnées.
Dans une visée communiste, faut-il « inventer » en excluant toute intervention étatique pour toutes les activités économiques de production et de distribution ? Ne faut-il retenir que les activités dont la propriété et la gestion relèveraient de structures collectives, associatives ou mutualistes ?
C’est un débat d’importance. Dans le livre de Friot-Lordon (référence 6, page 75) figure un paragraphe intitulé : Les échelles du communisme, dans lequel Frédéric Lordon traite du rapport entre le local et le global, pour expliquer que si « tout concours à un désinvestissement (en pensée) du niveau global, niveau de totalisation », « c’est une erreur de perdre de vue le global et le macroscopique ». Il part de de la forme ZAD pour discuter de ce qu’elle peut ou ne peut pas contre le capitalisme. A l’issue d’une argumentation poussée , il conclue que « c’est parce qu’il y a à la fois la nécessité matérielle du macrosocial et les périls politique du macrosocial, qu’il faut des autonomies locales, indispensable contrepoids aux tendances à la captation des institutions globales, tendances en effet totalisantes, et possiblement totalitaires. » On retrouve les questions de l’appropriation collective des moyens de production, des nationalisations, de la planification, de l’étendue du secteur public, de la régulation de la création des richesse et de leur distribution : les institutions publiques sont-elles seules habilitées à piloter, gérer et contrôler ces deux fonctions ? Cette verticalité ne comporte-telle pas des risques inhérents de dirigisme et de bureaucratie ? Ne génère-t-elle pas des rapports de pouvoir entre savants et sachants, entre sachants et utilisateurs ? Pour la contrebalancer, ne faut-il pas assujettir à cette verticalité une horizontalité qui permettrait de soustraire au pouvoir étatique de larges pans d’activités économiques et de services ? .
4- UTOPIES RÉELLES
Dans la socité capitaliste, il existe déjà des pans entiers d’activités qui relèvent de cette horizontalité. C’est particulièrement le cas dans les secteurs de l’économie coopérative et de l’économie sociale et solidaire, sous forme de SCOP, AMAP, Fablabs… Ces structures échappent, au moins en partie, à la logique capitaliste marquée par la propriété privée, le marché, la concurrence et le profit. De plus, y prévaut, à des degrés plus ou moins poussés, la gestion collective ou au moins partagée. On imagine sans mal qu’elles pourraient être consolidées et étendues à d’autres domaines dans la perspective d’une société communiste. On rejoint les considérations d’une école sociologique qui se réfèrent aux « utopies réelles », définies comme étant « des institutions, des relations et des pratiques qui peuvent être construites ici et maintenant qui préfigurent un monde idéal qui nous aident à atteindre cet objectif anticapitaliste »(réf. 10) Cette école prétend que la démultiplication des utopies réelles et leurs effets cumulatifs pourraient transformer progressivement le capitalisme en socialisme. Comme on l’a vu plus haut cette thèse qui assigne un rôle exclusif au local est plus que contestable. Pour autant, les exemples d’utopies réelles qu’il donne sont très intéressants, entre autres, les coopératives de production et de consommation, les fab-labs, la finance solidaire, le revenu inconditionnel de base, les assemblées citoyennes tirées au sort. Chacun de ces exemples mérite d’être examiné du point de vue de son degré de subversion du capitalisme.
5- LES DÉJÀ-LÀ COMMUNISTES
On se trouve au cœur d’une question cruciale que Lucien Sève aborde dans son livre (réf 1, page 250), selon laquelle « certains des aspects de la société communiste son déjà là ». Sève s’appuie sur Marx qui considérait que « des formes suggestivement post capitalistes parviennent à prendre naissance au sein même du capitalisme . ». Cela rejoint la thèse centrale de Bernard Friot selon laquelle il y a, dans la France capitaliste, deux « déjà-là communistes », celui du régime général de la sécurité sociale mis en place en 1947 sous l’égide du ministre communiste Ambroise Croizat, et celui du statut général de la Fonction publique instauré en 1946, sous l’impulsion du ministre communiste Maurice Thorez, Friot montre en quoi ces deux institutions sont, à l’échelle macro sociale, et restent, malgré leur défiguration partielle par les tenants du capital, des alternatives communistes aux institutions capitalistes. Dans la continuité des ces déjà-là communistes, il a théorisé le concept du salaire à vie ou à la personne, dont il a détaillé très précisément comment il pourrait être mis en place. Par la suite, le Réseau salariat qu’il a contribué à créer, a élaboré un projet de système de sécurité sociale de l’alimentation , selon une démarche parallèle à celle du salaire unique.
Ce qui est remarquable avec les deux institutions précitées, c’est que leur gestion est (était?) assurée exclusivement (ou presque) par les représentants des salariés, et qu’elles ne laissent ( laissaient?) à l’État qu’un rôle limité. Il en serait de même pour les extensions prévues par Friot. Ainsi, le niveau global, macrosocial, n’est pas nécessairement synonyme de dirigisme étatique, bien qu’en régime capitaliste il est en permanence exposé à cette menace.
Même si, dans une perspective communiste, cette menace était levée, on connaît par expérience les « tendances à la captation des institutions globales » (Frédéric Lordon). Ce tropisme serait d’autant plus puissant que le rôle de l’Etat pour des institutions globales serait jugé incontournable, ce qui pourrait être le cas de l’énergie, des industries de transformation, des transports, des banques…et ce, quand bien même leur gestion serait démocratisée, les salarié.e.s y prenant une part importante.. On en revient à la problématique global/local, qui fait écrire à Frédéric Lordon ((réf 6, page 84 : « s’il est nécessaire, le seul global admissible est celui qui laisse les latitudes maximales aux autonomies locales,, et même veille à les encourager, non pas par un généreux mouvement de « tolérance »mais pour y reconnaître rationnellement et l’une des sources de son efficacité et le garde-fou de ses propres dégénérescences ; » En d’autres termes, comment tenir ensemble tous les niveaux. Lordon ajoute que « le macroscopique, les institutions : tout se récapitule dans la question de l’Etat ». Dans une perspective communiste, quel est l’Etat qu’il faut inventer ? de quelles fonctions collectives, matérialisées dans des institutions, sera-t-il investi ? Comment et par qui lui sera accordé la légitimité nécessaire pour assurer ces fonctions ? Et encore bien d’autres questions complexes
Les forces collectives, politiques, syndicales et associatives, convaincues de la nécessité de dépasser le capitalisme ne seront pas de trop pour réfléchir à ces question, confronter leurs propositions, et apporter ensemble des réponses.
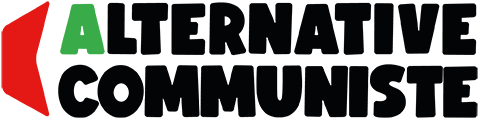



Laisser un commentaire