Ce mémo a servi de trame à la présentation réalisée par Serge Goutmann de la Sécurité sociale de l’alimentation lors de l’AG des communistes de Chelles, Vaires, Brou et Courtry le 29 mars 2025.
La sécurité social…
■ Avant d’explorer ces deux pistes d’extension de la Sécurité Sociale à de nouvelles branches (alimentation et culture), petit rappel sur les fondements de cette grande conquête sociale qu’est la Sécurité Sociale ;
| Cinq branches | |
|---|---|
| – Branche Assurance Maladie-Invalidité | CNAM / CPAM / ONDAM |
| – Branche Assurance Vieillesse | CNAV |
| – Branche Accidents du Travail | |
| – Branche Famille (Allocations Familiales) | CNAF |
| – Branche Autonomie (créée en 2021) |
La Sécurité Sociale aujourd’hui, c’est :
- 150.000 salariés
- 65 millions d’assurés (sur pop = 68 millions)
- 470 Mds € de prestations versées
Budget SS 2025: 666 Mds € (soit autant que le budget de l’Etat = 661 Mds € en 2025)
Soit un quart (24%) du PIB (estimé à 2.800 Mds €)
PM : Branche Retraites = 304 Mds € / Branche Maladie = 266 Mds € / Branche Famille = 60 Mds €
URSSAF : Organisme chargé du recouvrement des cotisations salariales et patronales :
- 648 Mds€ de cotisations perçues
- Soit un déficit prévisionnel 2025 de 22 Mds € (3,3%)
- Total de la dette SS = 264 Mds € (soit dix fois moins que l’Etat = 8,5% de la dette publique
- Amorti par la CADES qui perçoit la CRDS et la CSG (15 Mds€/an)
Déficit dû non pas tant par la hausse des dépenses (maladie ou retraites) et/ou de l’inflation que par la contraction des recettes :
- du fait du blocage des taux de cotisation depuis plusieurs années,
- du fait que les salaires n’augmentent pas,
- du fait des inégalités salariales hommes/femmes (impact sur cotisations = 24 Mds € !)
- du fait du chômage qui prive la Sécurité Sociale d’importantes ressources,
- et du fait des multiples exonérations de charges décidées par les gouvernements successifs (estimation = 65 Mds € / à mettre en rapport avec les 22 Mds € de déficit sur 2025)
■ Sécurité Sociale «à la française» = véritable mastodonte – qui va bientôt fêter ses 80 ans…
Anniversaire qui nous permet de rappeler les fondements de la création de la Sécurité Sociale en 1946, de voir en quoi elle constitue une spécificité française (mais aussi de prendre la mesure des attaques dont elle fait l’objet depuis le début par les tenants du capitalisme).
■ Créée par ordonnances du 4 et du 19 Octobre 1945 et mise en œuvre au cours de l’année 1946 par le ministre communiste Ambroise Croizat (ministre du Travail), la Sécurité Sociale unifie sous le statut du « régime général » le millier de petites caisses patronales ou mutualistes par régions et/ou professions qui existaient déjà au sortir de la guerre.
■ Prendre la mesure de cette conquête sociale que l’on présente souvent comme une mesure de justice sociale (concernant le droit à la santé) ou de solidarité, voire d’assistanat (concernant les allocations familiales) ou encore de solidarité intergénérationnelle (concernant le droit à une retraite digne).
■ Mais la Sécurité Sociale «à la française», c’est bien plus que tout cela :
- Près d’un quart de la richesse produite chaque année qui échappe (au moins partiellement) à la main-mise du grand capital
- Nouveau «partage de la valeur» – non pas entre Capital et Travail, mais entre ce qui est redistribué à chacun (chaque ménage) à raison de son travail dit productif et ce qui est mis « en commun» (part socialisée de la production) de sorte à assurer le principe «à chacun selon ses besoins» (et non selon ses moyens)
- Ce qui est mis « en commun» = prémisses du communisme, de l’organisation communiste de la société (cf. Spire : «Il y a plus de communisme dans la sécurité sociale que dans les soviets et les kolkhozes»)
- Forts de cette réforme à caractère révolutionnaire, les militants de gauche de l’époque (communistes et syndicalistes) retroussent les manches: En moins de six mois en 1946, 123 caisses primaires d’assurance-maladie voient le jour (par transformation de caisses existantes) et 113 caisses d’allocations familiales… sous l’égide de caisses nationales qui assurent l’égalité entre territoires. Démocratiquement élues..!
■ C’est bien pourquoi cette grande innovation sociale et démocratique se voit battue et combattue au fil des années qui suivent (…pas seulement pour faire des économies, mais parce que le principe même de la socialisation d’une part importante de la richesse nationale au profit de la satisfaction des besoins et des droits universels heurte de plein fouet les intérêts du capital) :
- Dès 1947, mise en place pour certaines professions de mutuelles complémentaires retraite
- En 1961, généralisation des complémentaires retraites avec l’ARCCO et l’AGIRC,
- En 1967, remise en cause de la gestion des caisses par une majorité de salariés (75/25) et instauration du paritarisme (50/50 entre patronat et syndicats). Dernières élections en 1983…
- A partir des années 80, la généralisation des complémentaires santé (sensées compenser le manque à gagner sur les remboursements de médicaments et de consultation par le régime de base) – complémentaires de moins en moins mutualistes, mais de plus en plus investies par les compagnies d’assurance privées (AG2R, groupe AXA…). Rendues obligatoires pour tous les salariés depuis 2016…
- En 1991, instauration par Rocard de la CSG qui déconnecte partiellement le financement de la sécurité sociale des lieux de production des richesses en en faisant un impôt à charge des contribuables et des salariés (et non plus des entreprises)
- Nouvelles attaques avec le plan Juppé en 1995, puis avec la réforme Touraine de 2014 sur le financement des retraites et l’allongement de la durée de cotisation, etc, etc…
- Instauration en 2004 de la T2A («tarification à l’activité ») qui a supplanté le financement des hôpitaux par un mixte entre dotation globale de fonctionnement et nombre et durée des séjours (ce qui prenait en compte la spécificité des établissement, des patients et des pathologies traitées) au profit d’une gestion purement comptable (ce qui, cumulé avec le principe d’autonomie des établissements, a conduit nombre d’entre eux à se retrouver en situation déficitaire…)
- Et bien sûr les mesures successives et répétées de déremboursement de médicaments ou d’instauration de franchises ou de « forfait hospitalier» qui touchent directement les assurés…
Malgré toutes ces attaques et remises en cause des acquis, la Sécurité Sociale reste un «bien commun » à défendre plus que jamais et à développer, comme une forme de communisme «déjà là » qu’il convient de conforter et d’élargir à d’autres pans de la vie en société.
■ Peut paraître utopique, voire déplacé, de vouloir réfléchir à des extensions possibles de la Sécurité Sociale (par ex Alimentation ou Culture) alors que l’urgence serait de défendre déjà bec et ongles le droit à la santé, la prévention, l’hôpital public.. si menacés ?
■ Rôle des communistes d’être présents et même d’organiser toutes les mobilisations populaires, sociales et politiques pour défendre et prolonger les acquis et les conquis. Rôle aussi des communistes d’ouvrir des perspectives et de dessiner les utopies concrètes qui peuvent donner à voir ce que pourrait être une organisation proprement communiste de la société…
Sécurité sociale de l’alimentation
■ L’idée d’étendre le concept de sécurité sociale à la question du droit à une alimentation de qualité pour tous (et en priorité pour ceux qui n’y ont pas accès aujourd’hui faute de moyens, qu’il s’agisse de foyers modestes, de familles monoparentales ou d’étudiants) part d’un constat :
- Plus de 8 millions de demandeurs aux différents guichets de distribution alimentaire type Restau du cœur ou autres,
- Pour les seuls Restos du Coeur (fondés en 1985), c’est 163 millions de repas servis en 2023-2024 = 75.000 bénévoles
- Un tiers des ménages vivant en France disent se limiter sur l’alimentation
- Les conséquences de la mal-bouffe sur la santé difficiles à mesurer statistiquement, mais obésité, diabète, cholestérol, risques cardio-vasculaires, etc…
- Autre conséquence : Difficulté pour les produits bio de percer sur le marché du fait de leur prix dissuasif… et donc difficulté pour les agriculteurs qui se sont convertis à ce mode de culture plus vertueux de se maintenir sur le marché de l’alimentation….
■ Bien que le droit à une alimentation saine soit inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (et que celle-ci soit reprise dans le préambule de la Constitution française), pas de transposition concrète (et encore moins de politique nationale). L’Etat s’en remet aux associations caritatives pour panser les plaies de ce fléau social qui représente pourtant en même temps un enjeu de santé publique.
■ Modèle caritatif non exempt de critiques :
- Du fait de ses limites objectives
- Du fait des effets de stigmatisation pour les populations concernées (qui se sentent diminuées en ayant l’impression de faire la queue pour demander l’aumône)
- Du fait de la non-remise en cause d’un système perverti : Sans le vouloir, l’aide alimentaire ainsi distribuée par les bénévoles participe au recyclage des invendus et des surplus du marché agroalimentaire en surproduction
- Les 220.000 bénévoles qui assurent les distributions (mais aussi auparavant les collectes auprès des supermarchés, le tri et le stockages des produits collectés) représentent une valeur économique évaluée à 600 M € (non payée), tandis que les «donateurs» que sont les producteurs, les industriels et surtout la grande distribution bénéficient de déductions fiscales représentant près de 440 M € (fausse philanthropie !).
- Quant à la mal-bouffe distribuée dans les enseignes discount et les restau fast-food, le discours dominant est de culpabiliser celles et ceux qui s’y adonnent, souvent en raison des prix cassés qu’on leur propose… On en arrive à parler « d’épidémie » d’obésité comme si c’était un virus?
. A ce constat désespérant, s’ajoute les interrogations sur les impasses de notre modèle agricole (boosté au nom de la concurrence internationale) à la monoculture et à la surproduction moyennant regroupement des terres et usage intensif de pesticides et autres intrants (au détriment des petits agriculteurs et/ou éleveurs attachés au bio et à la qualité de leurs productions).
. Sans parler des majors de l’industrie agro-alimentaire (souvent éclaboussés par des scandales sur la provenance ou la qualité de leurs productions), ou encore des géants de la grande distribution qui mènent la guerre des prix et écrasent les producteurs agricoles, les éleveurs et les pêcheurs, soit en achetant à des prix en-dessous des coûts de production, soit en rachetant eux-mêmes les exploitations artisanales pour monopoliser des filières entières (élevage, pêche, conserveries, etc…).
. Sans parler enfin de la PAC (Politique Agricole Européenne) qui va dans le sens de ces lobbies et alimente de fait l’agriculture ultra-productiviste au bénéfice des plus grosses exploitations..
Expérimentation de « caisses communes de l’alimentation :
- Au croisement de toutes ces interrogations et critiques sur le sens même d’une possible politique de l’alimentation qui préserve tout-à-la-fois le droit des consommateurs à une alimentation de qualité en quantité suffisante, et la défense d’un modèle agricole qui ne soit pas seulement celui défendu par la FNSEA (syndicat majoritaire), deux mouvements parallèles se sont développés depuis quelques années dans notre pays :
- D’une part la multiplication d’expérimentations à l’échelle locale de mise en place de «caisses communes de l’alimentation» à l’échelle d’un territoire, comme par exemple en Gironde, à Montpellier, en Alsace et ailleurs,
- D’autre part l’engagement de réflexions plus construites (ou plus théoriques) nées du rapprochement entre certains syndicats agricoles, des associations de consommateurs, des groupements de chercheurs en agronomie et des organisations politico-syndicales (comme le Réseau Salariat…).
- Pour ce qui concerne les expérimentations, j’en détaillerai une : Celle qui regroupe depuis Avril 2024 sous l’impulsion d’une association locale Acclimat’Action – quelques villes de la Gironde (Bordeaux, Bègles et autres) et qui consiste à tirer au sort 400 ménages volontaires pour participer à l’expérience. Moyennant une cotisation mensuelle indexée sur les revenus du ménage (à partir de 10 € et une moyenne = 45 €), la «caisse commune» donne la possibilité de se fournir dans des boutiques conventionnées (ou directement chez des producteurs conventionnés) pour l’équivalent de 150 € (en monnaie marquée = «Mona»)
Cofinancement :
| Cotisions | 214 K€ | 40% |
| Conseil Départemental | 150 K€ | |
| Ville de Bordeaux | 60 K€ | |
| Métropole | 20 K€ | |
| Région | 15 K€ | |
| Ville de Bègles | 10 K€ | |
| Etat | 70 K€ | |
| Total hors cotisations | 325 K€ | 60% |
- Il en va à peu près de même à Montpellier, ou à Toulouse avec un projet de «CaissAlim»… avec toujours le souci d’associer de simples citoyens intéressés par la démarche, des agriculteurs et des commerçants partenaires et des scientifiques et universitaires requis pour expertiser la démarche et ses effets concrets. Reste limité, et très dépendant de subventions publiques…
Discussion d’une proposition de loi en Février 2025 à l’Assemblée Nationale :
■ Dans la foulée de ces expérimentations, un député Verts (Charles Fournier) a voulu profiter de la niche parlementaire dont disposait son parti en Février dernier pour déposer une proposition de loi visant à autoriser et financer une expérimentation plus large que celle évoquée, toujours sur le même principe d’un budget alloué en monnaie marquée équivalent à 150 € d’achat auprès de producteurs ou de distributeurs conventionnés. Cette généralisation de l’expérimentation aurait pu toucher une vingtaine de projets de «caisses solidaires» de l’alimentation sur une période de 5 années, avant d’en faire le bilan et d’étendre le cas échéant à la création d’un éventuel Fonds National en faveur d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation. (NB = Coût prévisionnel de l’expérimentation : 35 M €)
Malheureusement pour ce député, bien qu’ayant fait l’objet d’un vote favorable en Commission, sa proposition de loi n’a pas pu être discutée ni votée en séance, car le temps imparti à la «niche parlementaire» des Verts était arrivé à son terme (du fait notamment de la discussion de nombreux amendements déposés par la droite et le RN pour retarder les débats..!
En tous cas, on voit poindre, au travers de toutes ces tentatives (en cours ou avortées), la volonté de poser quelques principes en faveur d’un véritable droit à une alimentation de qualité pour tous. Et ceux-ci s’inspirent assez largement des principes ayant prévalu à la création de la Sécurité Sociale générale, à savoir :
- Le principe d’universalité des allocations (égales pour tous, quels que soient les revenus, soit : « A chacun selon des besoins»)
- Le principe de solidarité (avec des cotisation proportionnelles aux revenus)
- Le principe de gestion démocratique (chaque caisse étant souveraine pour décider de sa façon de fonctionner et de gérer ses modes de conventionnement)
Mais l’on voit aussi les limites de ce modèle économique qui reste basé sur le principe d’une redistribution des moyens apportés pour l’essentiel par les cotisants eux-mêmes – ce qui pose un double problème d’égalité entre territoires (si l’expérience devait se généraliser – entre territoires bien pourvus et territoires défavorisés) et d’autre part un problème de non-remise en cause des logiques mêmes de l’organisation de toute la filière allant de la production à la consommation (au risque de rester très marginales face aux géant de l’agro-business et de la grande distribution).
C’est donc plutôt sur cette deuxième « ligne de front» que se positionnent les promoteurs d’une véritable «sécurité sociale de l’alimentation» (…mais il n’y a pas forcément d’antagonisme entre les deux démarches : expérimentaliste d’un côté, et stratégie révolutionnaire de l’autre – l’une pouvant avec le temps se nourrir de l’autre !).
Réflexions sur une véritable « sécurité sociale de l’alimentation »
■ Dès 2015, un rapprochement s’est effectué entre d’une part le Réseau Salariat (animé par notre camarade Bernard Friot), la Confédération Paysanne (syndicat agricole très opposé à la FNSEA) et le mouvement ISF (Ingénieurs Sans Frontières), l’UFAL (Union des Familles Laïques) et réseau VRAC («Vers un Réseau d’Achats en Commun» fondé et animé par un certain Boris Tavernier, lui aussi député écologiste…) – rapprochement qui a donné lieu en 2019 à la fondation du site AGRISTA qui essaie de «théoriser» la révolution que pourrait constituer la mise en place d’une nouvelle branche de la Sécurité Sociale.
■ Les modalités d’application seraient à peu près les mêmes : crédit universel de l’ordre de 150 € par mois et par citoyen (enfants compris) imputés sur une «carte vitale alimentation» – sachant que la dépense alimentaire moyenne aujourd’hui est plutôt de 230 € selon les ménages… Autrement dit, la «carte vitale» alimentation ne suffirait pas à couvrir toutes les dépenses d’alimentation, mais au moins elle assurerait un minimum vital à chaque individu. (NB : Coût total = 120 Mds €)
Mais le plus important serait surtout d’installer à l’échelle nationale une filière parallèle à celles de l’agro-business et de la grande distribution. Car c’est tout le système qu’il faut réformer, de la production agricole primaire (élevage, pêche et cultures vivrières) à la distribution (la plus coopérative possible par le biais de magasins conventionnés) en passant par les industries de transformation alimentaire (conserves, surgelés, plats préparés, etc…).
■ A l’instar de ce que la Sécurité Sociale générale a été capable de faire en matière d’accès aux soins et de droit à la santé, de construction de dispensaires, d’hôpitaux publics et de CHU, de sécurisation des personnels de santé (avec la création d’une fonction publique hospitalière), l’objectif serait de socialiser la plus grande partie de ce qui est aujourd’hui dépensé en matière d’alimentation (et majoritairement accaparé/marchandisé par les capitalistes du secteur) pour créer un véritable service public décentralisé (ou SIG – Service d’Intérêt Economique Général, pour reprendre la terminologie de la Commission Européenne).
■ Autrement dit de passer d’une politique de l’offre (à laquelle tout le monde d’ailleurs ne peut pas forcément accéder) à une politique générale de satisfaction des besoins (aussi bien des professionnels du secteur – agriculteurs en premier lieu, mais aussi préparateurs, transporteurs, restaurateurs, commerçants, AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), etc… qui bénéficieraient d’un «matelas» de commandes et de débouchés sécurisés – que des consommateurs eux-mêmes qui pourraient accéder à des circuits courts et à des produits de qualité : Enjeu économique et enjeu de santé publique donc, mais aussi enjeu de transition écologique (car les conventionnements à venir intégreraient des critères environnementaux stricts).
■ Le coût d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation étendue à toute la population = 120 Mds €, peut paraître énorme? Mais correspondrait à une nouvelle cotisation sur les salaires et les revenus des indépendants de l’ordre de 4 à 6% (à comparer aux 40% environs qui s’appliquent déjà sur la masse salariale totale)… (Et ce serait bien sûr encore moins si l’on faisait également cotiser les revenus financiers ?).
Intégrer les leçons de l’expérience
Mais s’inspirer de ce qui a déjà été fait et réussi dans le domaine de la santé, de la famille et du droit à la retraites, ça veut dire aussi être capables de tirer enseignement de ce qui n’a pas réussi, ou de ce qui fait l’objet de remises en cause de fond dans le système :
Dans son principe, l’Assurance-maladie a voulu, pour assurer le droit à la santé pour tous, sortir du tout-marchand.., mais elle n’y a pas totalement réussi. Si dans les années 80, elle a pu être à l’origine de la construction de nombre d’hôpitaux et de structures publiques de santé, si elle a pu (à partir de 1986) participer de la sécurisation de tout une partie des personnels de santé en créant notamment la fonction publique hospitalière, elle n’a pu échapper à une forme de mixité public-privé (qui a d’ailleurs tendance à de plus en plus tourner au profit du privé).
■ On le voit avec l’installation de cliniques privées au sein même des hôpitaux publics, on le voit avec la main-mise du privé sur la radiologie, sur l’imagerie médicale, sur les laboratoires d’analyse, sur les maisons de retraites rebaptisées Ehpad qui sont pour près d’un quart d’entre elles laissées entre les mains des réseaux à but lucratif comme Orpéa et bien d’autres…
■ On le voit, dans son mode de fonctionnement même, l’assurance-maladie solvabilise les patients qui consultent chez des praticiens libéraux qui, sans la sécurité sociale, ne feraient pas leur beurre, et qui au surplus n’hésitent pas pour certains à faire des dépassements d’honoraires conséquents.
■ On le voit enfin dans les remboursements de médicaments pris en charge par l’assurance-maladie, pour le plus grand profit des géants de l’industrie du médicaments comme Sanofi et autres, qui sont biberonnés non seulement au ticket de la Sécurité Sociale, mais encore aux subventions publiques type CICE et autres crédits recherche…
Bref, de là à penser que l’assurance-maladie sert de «vache-à-lait» pour la petite et moyenne bourgeoise corporatiste des médecins, des spécialistes et autres professionnels de santé, ou encore pour les actionnaires des géants de la santé privée type Ramsay ou autres.., il n’y aurait pas loin!
Raison pour laquelle il faut savoir tirer enseignement de ces déboires, et forger un projet structuré pour la future «sécurité sociale de l’alimentation» qui ne serve pas seulement à solvabiliser une partie de la clientèle potentielle des spéculateurs et autres affairistes, mais qui serve à subvertir complètement le système actuel et à se réapproprier démocratiquement toute la filière allant de la production à la consommation.
■ Pour être clair, nous ne parlons pas ici d’une «nationalisation» du système, ni d’une étatisation à outrance : A l’instar de ce qui aurait dû être la pérennité de la sécurité sociale (c’est-à-dire un organisme cogéré par les travailleurs du secteur, les élus et les citoyens), il faut imaginer la nouvelle branche de la sécurité sociale alimentation comme un ensemble de caisses locales, régionales, départementales (au plus près des besoins des producteurs et des consommateurs) sous l’égide d’une caisse nationale assurant l’équité et l’égalité entre tous les territoires de la République.
- Il ne s’agira pas non plus de faire de tous les agriculteurs ou de tous les distributeurs des fonctionnaires d’État (même si le développement de certaines structures publiques, coopératives ou associatives devraient pouvoir bénéficier de ce statut). Il s’agira de permettre un exercice communiste du travail indépendant pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteront continuer à exercer sous statut libéral ou artisanal, avec le «parapluie» optionnel d’un conventionnement leur assurant un minimum de débouchés et de revenus potentiels. Autrement dit : «Économie Sociale et Solidaire »…
En bref, pour la Sécurité Sociale en général (maladie, retraites, allocations familiales, etc…) comme pour la future Sécurité Sociale de l’Alimentation :
■ La logique «communiste» n’est pas de panser les plaies d’un capitalisme destructeur et de lui fournir des béquilles pour assurer son taux de profit (en solvabilisant la demande au nom de prétendus principes de solidarité au gré des rapports de forces instaurés par les mouvements sociaux et les mobilisations populaires), mais de subvertir le système lui-même – en «socialisant» le maximum de la production et de la consommation – sans que ça prenne forcément la forme d’une étatisation ou d’une collectivisation par le haut, mais en s’appuyant sur le dynamisme et la créativité de la population elle-même à partir de son esprit d’innovation sociale et démocratique et de sa pleine conscience des enjeux de classe en vue du dépassement du système capitaliste prédateur..
■ C’est le rôle des communistes que d’alimenter cette prise de conscience et de s’appuyer et de participer à toutes les expérimentations en cours (même si elles présentent des limites) pour faire vivre un «communisme» qui soit bien «le mouvement réel qui abolit l’état existant» (selon les mots de Karl Marx).
NB : Je n’ai pas évoqué l’objectif de gratuité de la restauration scolaire (corrélativement d’une véritable politique d’éducation à l’alimentation d’une part, et de la promotion des circuits courts en bio) pour ne pas alourdir ma présentation. Mais cet objectif devrait faire partie de notre «plan de bataille» pour reconquérir une véritable maîtrise socialisée de la chaîne de production alimentaire dans le sens de la satisfaction du droit à une alimentation de qualité pour tous et toutes (à commencer par le plus jeune âge). En tout état de cause, les 5 € par jour évoqués plus haut au titre de la «Carte Vitale Alimentation» ne suffiraient pas à assurer les deux-trois repas quotidiens des enfants, mais viendraient heureusement compléter la gratuité espérée des cantines scolaires. Même réflexion concernant les «tickets-restaurant» pris partiellement par les employeurs à défaut de restauration collective ? (Réflexion à poursuivre et à creuser.. !).
Rappel de quelques chiffres significatifs sur l’économie et les finances nationales :
- Produit Intérieur Brut = 2.805 Mds €
- Déficit Etat = 140 Mds €
- Dette publique = 3.100 Mds €
- Dont Etat = 2.587 Mds €
- Dont SS = 264 Mds €
- Dont Coll = 250 Mds €
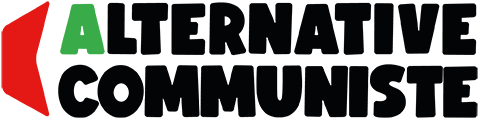



Laisser un commentaire